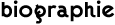Texte: Extrait du livre Laps clair édité en 2007 chez Domens
Laps premier.
Au-delà de mes épaules, toutes les forces s'en vont, tous les souvenirs deviennent ruines, ils ont la consistance des éprouvettes et des lumières bleues.
Mon effort est comparable au poids pris par l'ombre du monde, à son étirement dans les crépuscules, quant elle se fait salutation. Je monte, déguisé en homme, par ces roches noires comme la suie. Je m'appelle à l'oubli, j'ai besoin de me taire.
Je vais à ce mont des distances, à cette misère sèche, sans eau ni échos chaleureux. Je monte en tremblant, je monte pauvre, maintenant. Mes mains sont tuméfiées par le froid, par l'espoir.
Avec ce bleu il aurait fallu tant peindre, dans cette complicité sereine et enveloppante. Dans cette auréole qui sait si merveilleusement me couvrir dans un véritable froid. Ce froid qui m'abandonne endormi là, pour n'être rien, que moi.
Vivant à nouveau, je n'ai rien de plus. Corps de ma vie, si tu pouvais savoir maintenant, tu ne douterais plus de l'âme des animaux ni de leur pourcentage de sapience. Car ils sont véritablement animés par l'inutile pensée qui est la sœur de la peur, comme ils le sont toujours...
Il ne reste rien, et malgré cela me voici en train de glisser dans les plaines de l'absolu, peut-être sans mon corps, dans cet infini sans gris.
Toutes les anciennes douleurs de ma poitrine sont maintenant inconcevables, oublies. Il ne me reste là que l'orgueil, que le rire du rescapé. Et le dédain envers les dieux m'habitera j'en suis sûr.
Il n'y a pas de musique, ni des tonnerres nuptiaux dans cet automne doré. Ni les jardins, ni mes mains enterrées ne m'importent, je ne crois plus.
Glacée sans rigueur ni température, mon ombre est une forme sans corps.
Je voudrais être porté en amont de ces falaises vers l'autre berge, dans le corps fatigué de mon village.
Défendez-moi devant la critique, accompagnez-moi cousins. Et aux travers de vos tempes faites de portes, dites-moi si la direction peut me donner le sens.
Mes flancs sont orphelins maintenant, et dans ce bleu sans couleur qui m'étouffe en me serrant vers le haut, toutes mes forces montent…
Tous mes jours sont écourtés par les distances, toutes les heures demeurent rongées par l'épuisement. Je suis fracassé par ce qui est parti. Mes images sont érodées, usées, et je les transforme, mais je ressens que le pardon m'abandonne. Je ne peux pas me pardonner.
Je m'apprête à courser les marches équivoques de ma présence, malgré tous les dangers que j'imagine, malgré ma peur de la peur, je suis moi-même sans miroir ni forme définie.
Il y aura à la fin, peut-être un ange sans âge, toujours là et toujours en servitude en vers les heures transcendantes. Pour moi maintenant il ne reste d'autre chemin que celui d'oublier en voguant au-dessus des moisissures de ces roches frontalières, je suis pressé, je suis mystère.
J'étrenne ce silence, au loin, je ne devine plus les rires cahoteux et les lauriers roses, je les laisse à d'autres passagers. Ma vierge a la couronne refaite, ma défaite et mon plus se réjouissent et jouent pendant que le temps, ce traître, les dissout.
Mes membres taris et sans geste voudraient se représenter en apothéose, avec de lumineuses chairs enflammées sans autre corps que celui que la lumière peut rendre. Je désire être en ce moment une monture roussissante qui survole ces galets muets. Et mon rouge lumineux ne cesse de traverser un espace sans place qui tient dans une résonance bleue. Ce sont ces couleurs matinales, ce sont elles les insultantes avec leur parfait manque de chaleur, avec leur destinée affinée. Il n'y a pas d'autre quotidien que la morsure du froid symbolique et ce voyage déclenché comme une chute.
D'ici je conviens à dire une fois de plus que l'âme des animaux est trop supérieure à leur conscience et que leur perception n'est pas verticale. D'ici je peux voir les machineries qui ont mené à bien la construction de l'arc qui me propulse aujourd'hui.
Quel est ce nom que crie Baptiste, pourquoi passe-t-il en se lamentant, pourquoi ne voit-il pas que je suis délivré du quotidien, et que cela me soulage? Délivré du bleu du ciel pour tomber dans le bleu de ce songe, dans quel pays suis-je? Je suis si épuisé. Je me vois bien au-delà de ma charpente, loin de mes poussières. Je suis six, mélangés dans ma mémoire.
Peut-être la nuit viendra-elle, avec sa peau tannée, amenant la délivrance de mon doute avec son fauteuil endormi? Mais ces nuées ne sont pas des vapeurs soulagées de la mer.
Ma torsion est si forte que je perds mon ombre. Mon intérieur se ressent comme le corps d'un vieux bateau, détérioré par les coutumes de l'équipage.
Il me faudrait une cuirasse, comme celle d'un chevalier quelconque, il faudrait farder mon courage d'acier, pour que j'affronte les cercles fantomatiques que dessine l'horizon. Je cherche la valeur qui me permettra de voir sans détour la somme de mes grimaces sans pénitence avec l'arrière-pensée de l'incertitude des temps à venir. Et malgré tout je sens en moi la voix de mes colères, mes offrandes volées, mes fractures. Et je me demande si ici encore on peut se distraire et s'il y a une fin dans ce nuage intérieur. Où est l'achèvement, où est le déroulement si pratique que mettait en œuvre le vivant.
Encore ce bleu des frayeurs, encore ce coton si semblable aux délices les plus passionnés. Pour traverser, il faut que je cherche l'inertie brutale de ma carcasse fauve. Ridicule, je me sens muet, plus pour avoir compris l'intimité de la parole que pour la perte de la faculté de dire. Je me sens mort dans cette propulsion copiée aux mythes. Sans responsabilité, je désire devenir impersonnel, ne me vêtir d'aucun habit, perdre cette défaite, cette figure de fou bouffon.
J'attends ce monde sans siècles, ce monde de la joie statique et je ne supporte plus cette idée. Je pleure de l'offense faite aux bons vivants.
Soudain, mon vol rencontre le bruit coloré de la foule, qui se tient là de l'autre rive. Tous sont là, pris par leurs habitudes. Je ne sens pas encore le désir de parler, d'abord je veux voir. Et je voix ce vacarme de vautours, rester autour de ma dépouille.
Je chérirais le plus au monde ce qui était sain, ce qui reste des heures de pluie, ce qui me fait rester là, à chercher dans la prochaine nuit toutes les choses qui m'ont fait d'acier. Ce sont peut-être elles qui me font rebondir au-delà des rochers de l'écho. Comment suis-je monté là, au-dessus de mes forces? Avec quel honneur vais-je me présenter à quiconque croisera ma nouvelle forme ?
Je n'ai pas de résonance, je n'ai pas de réalité ni d'occasion, mais en moi il persiste encore l'unique raison qui m'a constitué.
Mes travaux, mon appétit pour étrangler, mes effrois peuvent me servir. Je dois rester calme, porté par ce gouffre qui a omit ses charpentes visibles. Je me sens désormais dans une de ces décantations de couleurs vitrées. Ce paysage est toujours occulté par le quotidien. Il est étonnement respectueux, même affectueux mais sans personne, sans aucun être qu'on puise rejoindre. Et la vie, les coutumes et les gens paraissent sans apparaître dans la masse de ce gouffre qui semble posséder la raison. Rien n'est présent, mais tout ce que je pourrais posséder m'importe, car je sais que tout est là, sauf les lamentations, sauf les mélancolies étrangères.
Je n'ai d'autre bagage que mon caractère.
Il ne peut y avoir ici de jugement. À chaque instant, la vie soupesée et offerte va et vient, elle devient belle et gratifiante ou au contraire elle est la messagère léguant la disgrâce, nous attirant dans des couchers de soleils suspicieux avec nos petits malheurs journaliers qui de temps en temps mûrissent dans une catastrophe. Ainsi l'existence finit par ce fausser, et en même notre fraîcheur infinie comble les nuages.
De là j'attends les dieux qui eux attendent le dimanche, de là j'entends toujours la cour de l'école où les tragiques mensonges qui nous discréditent peuvent achalander graduellement la distance nécessaire à la configuration de chaque famille.